
Plein air
La vraie nature
des inukshuks
L’inukshuk est une structure de roches que les Inuits utilisaient comme point de repère dans le Grand Nord canadien.
Dans leur culture millénaire, il symbolise la fraternité, l’entraide et la solidarité. On le retrouve désormais partout en statuette dans les magasins de souvenirs au Canada ou sur les sommets des montagnes foulées par
les randonneurs où il sert encore de repères directionnels.

Un inukshuk figure sur le drapeau du Nunavut, territoire canadien peuplé par environ 85 % d’Inuits Il était également le symbole des Jeux olympiques de Vancouver en 2010.

Disposés en groupe, comme des épouvantails de pierre, ils menaient les caribous dans un cul de sac naturel, comme lieu d’embuscade pour les chasseurs.

Les inukshuks sont souvent confondus avec les cairns, eux-aussi constitués de roches superposées, mais de forme conique.
Une tradition millénaire
Bien qu’on la connaisse surtout sous le nom d’inukshuk, cette structure constituée d’une tête, de bras et de jambes est plutôt un inunnguaq, signifiant « qui ressemble à un être humain » en langue inuktitut.
Visibles à plusieurs kilomètres de distance dans la toundra, les plus hauts inukshuks marquaient les limites d’un territoire.
Si un panache de cervidé était posé sur l’inuksuk, de la nourriture était enfouie sous un tas de pierre à ses pieds.
La hauteur peut varier de 30 cm à 1 mètre
Son bras le plus long indiquait la position du village le plus proche ou de la direction à suivre.
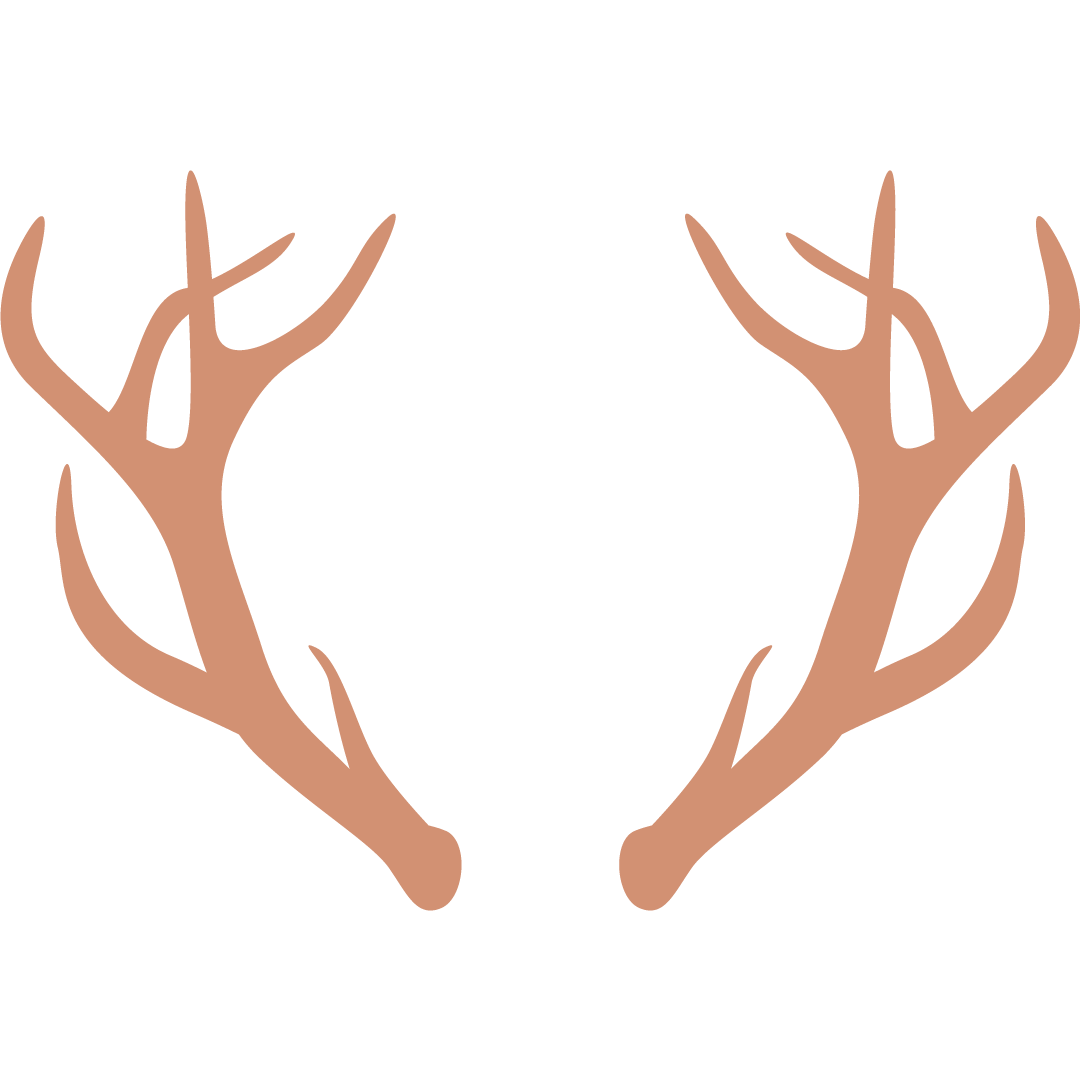

Pourquoi ne faut-il pas construire d’inukshuk n’importe où au sommet des montagnes ?
◼︎
Des randonneurs ont repris le concept des inukshuks pour indiquer la direction à suivre sur les montagnes en cas de brouillard ou lorsqu’il n’y a pas d’arbres pour marquer de repères à la peinture. Il est donc important de respecter ces inukshuks « officiels » et d’éviter d’en créer de nouveaux ou de modifier ces derniers.
◼︎
Au-delà de la sécurité des randonneurs, déplacer des roches dans un environnement sensible peut contribuer à l’érosion des montagnes ainsi qu’à la détérioration de l’habitat des animaux et des insectes.
en cinq minutes
Recherche et rédaction : Frédérique Sauvée
Graphisme : Sébastien Dorion
Design et expérience numérique : Steeve Raynaud
Vidéo et photos : Envato et Adobe Stock
Sources : L’encyclopédie canadienne, Radio-Canada, Espaces.ca
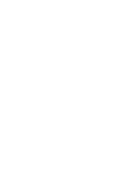
© Le Journal de Montréal Inc. Tous droits réservés.
